Justice et État-Civil
Le scel aux causes du magistrat d’Estaires porte un écusson gothique chargé d’une fasce sans indication de couleurs avec l’exergue : sig. scabinorum destaires.
Vers 1328, le comte Louis de Nevers confirme les libertés de la ville d’Estaires. Ainsi Estaires avait sa commune dès lors établie, ses lois; nous avons eu occasion de les connaître dans la réédition de 1609.
Cassel, outre ses huit « viersaeres », possédait des seigneuries connues sous le nom de vasseleries ; Estaires, Merville et les paroisses de son décanat étaient de ce nombre.
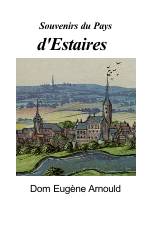
CHATELLENIE DE CASSEL
Avaient juridiction criminelle
|
|
A la première porte d’entrée du château d’Estaires siégeait le tribunal de la vierscaere d’Haveskerque.
Les quatre moyennes justices dépendant de la cour de Cassel au XVIIe siècle, étaient : Cassel, Hazebrouck, Watten et Estaires. On voit leur blason dans l’in-folio Coutumes et usages de Cassel : Estaires, Stegers de Steg, pont, travail en bois, échelle, probablement pont de bois, porte : coupé d’argent sur gueules à une croix ancrée coupée l’une dans l’autre. (Comité flamand, tome VI, p. 46.)
1395. Le pont d’Estaires est mentionné dans le dénombrement des biens de Yolande de Flandre, qu’elle tient en fief de Philippe le Hardi, comte de Flandre. (Voir Seigneuries.)
Engelbert d’Enghien obtint, le 15 juillet 1436, des lettres d’accroissement d’Estaires sur la seigneurie de Neuf-Berquin (*).
En 1474, un incendie dévore la ville. Estaires et toutes les chartes sont la proie des flammes.
Le comte de Flandre maintient, par lettre du 22 janvier 1481, certains sergents sur la frontière et le long de la Lys à la requête de Cassel, Bailleul, Warneton, Estaires, Merville.... (Archives de Bailleul, en flamand.)
(*) II y avait à Vieux-Berquin les seigneuries de : Bleutour, Oudenhove, Mauroy, Beaulieu, Ophove, Terlinde, les deux seigneuries vicomtières de Coudescure, Soodsacker, Berquin-Plessis;
A Neuf-Berquin : paroisse et seigneurie de Neuf-Berquin, Mote, Planke, Nieuland, Walgracht, Van den Brùssche, Onderghem, Longams, Remi-Leke, La Morianne.
Le conseil de Flandre déclare, le 22 février 1481, que les villes de Cassel, Bailleul, Estaires, Merville et autres le long de la Lys, réclament à la ville d’Ypres au sujet de leur contribution à la dépense pour la défense des frontières. Ypres soutenait que lesdites villes avaient refusé les 1725 livres parisis, monnaie de Flandre, qu’elle leur avait offerte, ainsi que cent hommes sous la conduite du sieur de Caestre qu’Ypres avait envoyés auxdites villes, et Ypres refusait de rembourser cette somme de 1725 livres. (Documents pour Bailleul. – Ignace De Coussemacker.)
Philippe de Bourgogne autorise, en 1497, Estaires à mettre sur ses rôles d’imposition des fiefs revendiqués par le Neuf-Berquin. A la requête des avoués et échevins d’Estaires auxquels appartient la connaissance et indication des fiefs situés en leur ville d’Estaires, de leurs droits et privilèges, sauf en matière réelle et propriétaire. Ceux de Neuf-Berquin auraient usurpé leurs droits par la faveur de Charles de Batrelet, auquel appartenait un de ces fiefs, et qui était bailli d’Estaires et châtelain du château d’Estaires, et favorisait ses parents qui habitaient ce fief.
Charles-Quint confirma, en 1515, le marché d'Estaires fixé au jeudi et la foire fixée au 21 juillet, autorisant le rétablissement des fabriques de draps « que la guerre avait ruinées. » Avant le désastre de 1474 on y comptait 874 métiers. Le même souverain établit différents droits d’octroi pour la réparation des chaussées. (Ordonnance du 11 juin, scel de Charles V armé et à cheval, cire verte, corde de soie rouge et verte).
« Estaires, dit le mémoire de la ville d’Estaires contre le chapitre de Saint-Pierre à Cassel et l'abbaye de Chocques(1744), était alors la plus grande et la plus peuplée des paroisses de l’évêché de Saint-Omer. »
Le 13 juillet 1557, les échevins de Bailleul décident que conformément à la hanse qui existe entre leur ville et celle d’Estaires, les bourgeois d’Estaires ne peuvent être arrètés ni poursuivis pour dettes devant les échevins de BailleuI, mais qu’ils doivent être renvoyés devant leurs propres juges. (Ignace De Coussemacker, Documents pour l’histoire de Bailleul).
A cette époque, les huguenots exerçaient leurs ravages. Pour se défendre, Estaires élève des portes et des barrières, et le roi autorise un impôt de 6 deniers sur vin et bière pour solder un arriéré de 1 000 livres de gros et achever les chaussées et les portes. En 1574, le roi Philippe II autorise un nouvel impôt pour le même effet.
Des forts avaient été élevés sur la Lys, moyennant la somme de 14 000 florins fournis par Bailleul à l’ordonnance du seigneur de la Motte, « dépens supportés par Sailly, Estaires et ailleurs. » Alexandre de Parme, gouverneur des Pays-Bas le 12 novembre 1581, en exige la prompte liquidation. (Documents pour l’histoire de Bailleul. – Ignace De Coussemacker.)
Le 27 juillet 1589, il y a un accord entre l’abbesse d’Anay-en-Artois et les échevins de Bailleul et Estaires au sujet de la contribution afférente aux tenanciers de ladite abbaye en la seigneurie de la Brayelle, dans les charges de la seigneurie de Bailleul et la ville d’Estaires. (Voir Seigneuries.)
Onze articles, signés : Benoit Delebecque, avoué, Pierre Legillon et Abel Terchere, échevins d’Estaires, assistés de M. Charles Lefrançois, receveur et greffier dudit Estaires. (Documents pour l’histoire de Bailleul. – Ignace De Coussemacker.)
Le 7 avril 1590, le roi approuve la confrérie des archers de Saint-Sébastien établis par les seigneurs d’Estaires en juin 1589.
Le 28 septembre 1592, à la requête de la comtesse Anne de Pallant, le roi d’Espagne rend un arrêt relatif au cabaret du Pont de la Meuse :
|
« Contenant que depuis quelque temps en ça ung nommé
Jehan Faulconnier, battelier, aurait construit certaine maison sur une
prairie et le bord de la Lys du côté de Laleube, vis à vis le rivage
et le chasteau dudict Estaires... » |
En conséquence, le roi fait fermer ce cabaret, qui depuis a
été rouvert, et une infinité d’autres se sont établis pour étancher les
Estairois toujours assoiffés de leur antique bière flamande, laquelle, pour
antique soit-elle, ne contribue guère à sanctifier les habitués des cabarets.
Mais les brasseurs vont nous en vouloir. Il vaut mieux rappeler les vers que Mgr
Dehaisnes trouva sur un vitrail du XVIe siècle dans une ancienne
brasserie de sa famille à Estaires, aujourd’hui cabaret du Lion d’or, sur
la grande place ; le vitrail représentait saint Arnould, évêque, patron des
brasseurs :
|
Sainct Arnould, ce
grand patron, |
Devenu prélat romain, Mgr Ch. Dehaisnes a pris pour devise de ses armes le dernier de ces six vers, le sens modifié par l’isolement. Toute sa vie fut-il le plus serviable des savants et le plus aimable des prélats.
Nous avons parlé du Pont de la Meuse. C’était une barque au temps de Sandérus qui passait les amateurs d’aller vers La Gorgue. Le droit de pontenage de dessus et dessous le pont d’Estaires appartenait moitié à l’abbaye de Saint-Waast, moitié aux seigneurs. Un acte du commencement du XVIIe siècle mentionne le pont vers La Gorgue.
Estaires avait une foire le 22 juillet; Armentières en ayant obtenu une le 9 mai, celle d’Estaires s’en trouvait amoindrie, c’est pourquoi Estaires demande et obtient une seconde foire en octobre. – Lettres du 21 juin 1606.
Les archiducs font une ordonnance, le 15 décembre 1612, pour autoriser la ville d’Estaires à emprunter 10,000 florins au denier 16, pour la reconstruction des halles. L’année suivante de nouveaux emprunts sont faits le 26 mai, et en 1614 le 18 novembre. D’autre part il fallait reconstruire la tour de l’église. Des lettres patentes datées du 12 avril 1614, données à Bruxelles par le comte et la comtesse de Flandre, autorisaient la ville d’Estaires à s’imposer jusqu’à concurrence de 18,000 florins. La tour avait été « entièrement brulez et ruinez par les rebelles qui occupaient le château du Doulieu. »
Un registre des députés des branches de la généralité de la paroisse d’Estaires qui contient la mise en ferme des principaux revenus de la ville, de 1603 à 1626, se rencontre dans les archives. Parmi ses vingt articles, signalons :
|
« Le cellier de la ville d’Estaires dessous la halle, appartenant à la ville.... – L’awardaignes pourchaulx en ladicte ville à prendre de chacun gros pourchau par le fermier.... – La pescherie des fossés de ladicte ville depuis l’embouchure de la Lys auprès du rivage jusqu’au pont allant à La Gorgue, elle est délaissée à Madame pour l’usaige de sa maison, jusqu’au rappel de la ville, Pour la pescherie desdicts fossés depuis le pont de la porte de La Gorgue jusqu’à la porte du Moullin... et à la porte des Levis... pour l’an de ce rebail... n’a esté baillé en ferme pour cette année.... |
Signé : de Niewendenbyse, Le Becquet, Jean Faulconnier, Becguin, Jacques Bouchier. »
Ce document nous révèle l’existence du pont dit de la Meuse aujourd’hui, et de différentes portes ; celle de l’église se trouvait en face du portail actuel, la porte du moulin sur la route de Cassel avait deux tours.
En 1624, 1626, la peste sévissait sur la population pauvre d’Estaires. La ville, épuisée par les vides ordinaires et extraordinaires, dut emprunter pour secourir les pestiférés.
Philippe IV autorise Estaires à lever une nouvelle « taxe et recepte pour l’entretenement des pauvres qui sont en grand nombre pour la présente calamité des temps, pour deux années. » – (Donné à Bruxelles le 20 décembre 1633.)
Le magistrat décide qu’une maladrerie serait adjointe au couvent des Récollets, le 23 octobre 1636, à cause de la continuation de la maladie contagieuse, et le curé réclame l’assistance des Récollets pour l’administration des sacrements. Cette maladrie ou maladrerie était, ce semble, une nouvelle, la première ayant dû être vendue vers 1620 au profit des écoles des Récollets. (Voir Récollets.)
On trouve aux archives communales un registre aux délibérations des députés des branches de la généralité d’Estaires. On y voit que le pays a souffert pendant l’année 1634 « toutes les calamités que la guerre entraîne à sa suite. » En cette année figurent dans les registres les noms suivants : Guillaume Faulconnier, Cl. Lespilet, pasteur ; de Meester, bailli ; Mathis Theette. L’année suivante : Le Gillon, Pierre Mathelin.
L’assemblée de la généralité en 1635 se compose de :
Dans la ville, MM. bailly et eschevins.
Pour la vierschaère : le sir bailly de Meester, Pierre Bruns et Nicolas Boullengier.
Avec les passages de troupes, réquisitions et autres dommages que la guerre valait à Estaires, sa compagne la peste y avait élu domicile depuis plus de dix ans, s’attaquant surtout à la population pauvre.
|
En octobre 1636, « as este résolu que pour se deffendre des incursions et voleries que pourraient faire sur ceste paroisse les soldats qui durant l’hiver prochain pourraient estre en garnison au pays d’Artois et de Lalleu, de pourvoir aux dépens de la paroisse trois cens livres de pouldre, guatre cens livres de plomb pour reposer en la tour.... comme aussi pour plus grande assurance, de faire une porte au pont d’Estaires et une barrière près le pont de La Gorgue, et commestre une garde aux dépens de cette paroisse, et guet sur la tour de douze hommes et un chef, et en outre de se pourvoir de mousquets et armes, pour la monture desdicts hommes, comme en ayant besoing. » Signé comme ci-dessus, en 1634, plus : Mathieu Spetebroot. |
La ville prend la résolution, en 1638, d’accorder à Madame la princesse de Robecque un présent de quatre cents florins pour les « grands debvoirs et sollicitude qu’elle a eu constamment pour la conservation de cette ville et paroisse.... » On se plaint encore fort des pillards, et l’on songe à établir contre eux des barrières.
Quelques actes de l’état civil d’Estaires entre 1594 à 1718
Il n’est pas sans intérêt de connaître des noms relevés dans les actes de l’état civil d’Estaires depuis 1594
|
1594. Mathieu Berthoul, Jean Peulmeulle, Louise de Bachimont, abbesse d’Anay; Isabeau Pelizère, Is. Lombard, H. Buret, Denis Crouée, Mathieu Van Nieuheuse, Jeanne Le Franchois, Nic. de Winde, François de Meestre, Marie de Vos, Adrien Schriekius, Al. de la Barre. 1595. Pierre Faulconnier, Anne Patou, Jean Descamps. 1596. Pierre Gillon, Mme de Glayon, M. Le Gillon. Anne Le Brun. 1597. Marie Blaise. 1598. Luc du Mollin, Fr. Springher, Ant. Delattre, mayeur d’Aire ; Jean Hellebaut, Marie Le Sur, Fr. Maupetit, Mgr Ladmoral, vicomte de Hornes, Mme la comtesse de Herlies, Fr. Westrelin. 1599. Mgr de Furnes, Vincent Meurin, prêtre ; Guil. Houvenaghel, Etienne de Neuveeglise, Jacquemine Wicart, Thomas Harduin, Hélène Roussel, Marg. Boulet. 1600. Jean Romon. 1601. Phil. le Maire, Anne de La Buissière, Jean de la Hail, Mgr de Haguedorne, Péronne de Groote, Fr. de Walles, P. Brasmes. 1602.Ant. de Bourges, Jeanne de Poucques. 1604. Gilles Herman, Jacqueline Cleenwerck. ’ 1608. Adolphe de Walquenaert, Henri de Valois, H. Le Febure, Julienne de Mérode, Jean Le Lièvre, seigneur des Watines ; Mme Anne de Pallant, comtesse d’Estaires, Wallerand Brice, Pierre Le Chierf, Henri do Cornehuse. 1609. Fr. Grave, Franchoise Hadou, Pierre Dupretz, Jean Martin, Marguerite Brassart, Isabeau de Ghistelles, Jean Westeen. 1610. Pierre Plouvier, Claire Clefs. 1613. D. Guillaume, bachelier en théologie, curé; Madeleine de Lannoy, Antoine Acquart, Philippe Arnould, M. Franchois. 1614. Antoine Fournier, Fr. de Saint-Jean, Ant. de la Tour, Jeanne Merlin, Ant. de Froom, bailli de Corbie et de la Lys ; Jeanne Gallois, Petronille Flocteau, Catherine Waremhourg, Ant. de le Forge, Ant. de Wein, Louis de Gransilier, André Le Bel, G. Barizel, Jacques de Riencourt, Jeanne Le Dieu, Marguerite de Haine, Robert de Lens, Jean Le Jeune, J. du Metz. 1615. Louis de Toupey, Catherine du Chastel. 1617. Bernard de Bacquerol, J.-B. Bauduit, Bte Salingier. 1618. Jeanne du Riez, Jean d’Auchy, Ph. Courbet, Antoine d’Artoy, El. Van Eslimen, Ant. seigneur de Mazingbem, Claire d’Estourmel, fille du baron du Doulieu; J. Lucart, Jacq. Monnier, pasteur du Doulieu ; Ant, Le Roy, Jean Didier, Jean Le Duc. 1620. Ph. Holbec, Isabelle Vasseur, Vaast du Plouick. 1621. Marie-Thérèse, Nic. et Hélène de Montmorency; Madeleine de Lens, Mad. Doublié, les seigneurs M. M. de Neuville et de Bonnières, la dame M. de Westoutre, Barth. Le Josne, Isabelle de Bavinchove. 1622. Guil. de le Val, abbé de Chocques, précédemment curé d’Estaires ; Louis de La Barre, curé ; Fr. de Wastrelet, Cath. Chavatte, Marie de Potte, Anthoine Hier, Jacq. de Coussemacker, D. P. Quenillart, religieux de Chocques 1623. Isab. Dathis, M. de Wourmes, Isabelle Carpentier, Florent du Four, Ant. Berte, dame Julienne de Mérode, vicomtesse de Furnes; Jacques Capon. 1624. Jeanne Hecquin. 1625. Phil. du Hocq, Hector Vandremes, Phil. du Bodquin, seigneur de la Haie; Marie de Noyelles. 1626. François Titprez, Marguerite Plonquin, Jean Billau, Anne Maupetil, abbesse de Beaupré; Phil. du Bacq, Siméon de Houplines, Marg. Cuquelhouse, Claude de Prouville. 1627. Max. Cuvelier, Ch. Desplanques. 1628. Jacques de Melanthois. 1631. Jeanne de Boyavalle, Reg. de Lattre. 1632. Jean Schoutteeten. 1633. Elisabeth de Vicq, Isabelle de Bourgogae, Nic. de Vulf, bailli de Steenwerck; Lespillet, curé; Maximilien de le Val, seigneur de la Marche; Marie de Harlebecque, Jean de Revel, 1634. Adrien Grugeon, Jean de Fleurbaix, François Hennion, Christine Sonneville, M. Revel, Isabelle de Oust, G. Le Mire, X. de Calonne, chapelain. 1635. Gabrielle de le Pierre, Sibille Embry, Françoise de le Warde, Anne Morel, D. Bauduin, gardien ; Louis Colpart, El. Wastelier, Jeanne Charles. 1637. J. Le Bon, d’Artois, que la guerre a chassé dans cette paroisse; Marg. Gamelin, Cath. des Maretz, Nic. Vanacre, licencié en droit. 1640. Maurice Bar, D. G. Martel, religieux Trinitaire d’Estaires. 1643. Christine Hamelin, Bern. Leurin. . 1644. Ant. d’Héricourt. 1646. Nic. Bridel, Jacques Salomé. 1648. Corneille de Lespine, Jeanne de le Bien, J. Marquant, chapelain. 1649. Fr. de Noord’s, Pierre Bourrable, vice-capitaine au régiment de Furstemberg; Jacq. Despierres, P. de Springher, senator civitatis. 1650. Marguerite Godschalk, Florentine du Bois, Isabelle Ghorris, Marie de Loigny, Is. Mathallin, ex turmis Lotharinghis. 1651. Laurence de Courty, Balthasar Godsvim, Beatrice Dupont. 1652. M. Van Marchis, Fr. du Jardin, curé; Louis Follet, P. Domarles. 1653. Jean Casy, capitaine; Eléonore Ash, 0 Maur Mac Mahon, satellis major; 0 Marie Mac Cragh, Jean de Maire, Michelle de le Motte, Aug. Dubois, du régiment de Limbèque. 1655. Fl. Le Brun, receveur du prince. 1660. Caroline de Baillencourt, Fr. de Maldeghem, Jeanne Lands, relicta Dni Wattrelet. 1662. Phil. du Château, G. de le Sand, D. R. Ph. du Jardin, abbé de Chocques ; Massart, curé ; Marie Despatures, Fr. Manniez, Madeleine de Bailleul, Fr. Baillencourt dit Courcol, Anne Dankar. 1664. Juvenal du Brule. 1670. Bauduin Cornillot, Marie Le Secq, G. de Lestrée, chapelain de Merville (en 1674 curé de Merville). 1676. Hugon de Marles, avocat de cette ville; Marie Taffin, Ant. de Laval, Marie Vignoble, André Theeten. 1678. Ph. Garbe, prêtre; Monnin, prêtre; Jeanne du Sart. 1683. Anne de Grave. 1695. Jean Fr. Le Gillon, écuyer, seigneur de la Cordonnerie ; Mathieu Bailleul, meurt en 1695 et est inhumé dans la chapelle de Notre-Dame de Consolation, par lui fondée. 1696. J. Chavatte, prêtre; Anne Trinel, Ch. Le Brun, échevin, VanHouck, doyen. 1697. Juvenal de Meester, pasteur de Godewaersvelde; Rohart, pasteur d’Estaires (Rohart : d’azur à un lapin passant d’argent). 1698. Pierre Gallois, avoué de La Gorgue; Philippe Laurent, procureur de la ville d’Estaires ; du Verbois, prêtre ; Theelen. greffier; F. Ratfel, chirurgien. 1699. Laurent Parent, bailli de Watterlet. 1700. Adrien Ducros, apothicaire; Marie Sebastien, fille du grand bailli d’Estaires. 1712. Louis Sebastien, bailli (portait : de gueules à une équerre d’or). 1715. Ph. Laurent, notaire et tabellion d’Estaires. 1716. Ch.-Jos. Vermersch, greffier du Pont d’Estaires. 1718. Antoine Sacy, seigneur de Wastines; André des Madris, maistre d’écolle; J.-B. Duquesne, chirurgien à La Gorgue ; J.-Fr. Blanquart, receveur de domaines au Pont d’Estaires. |
Estaires donne, en 1672, sa maladrerie à l’ordre du
Mont-Carmel et Saint-Lazare. Nous croyons que cet hospice était situé sur la
route de Neuf-Berquin. La même année, la ville prête 19,000 livres parisis à
la viersgaerte de Zuit-Berquin. (Vierschaere de Neuf-Berquin.)
On appelait vierschaere une assemblée de justice de second ordre.
Le magistrat du château de Cassel était le seul à s’appeler cour dans les Pays-Bas. Les chefs-collèges ou la réunion des députés des châtellenies de la Flandre maritime s’y assemblaient une ou deux fois l’an pour les affaires concernant les finances de la province.
Toutes les justices de la châtellenie de Cassel reconnaissaient la juridiction criminelle de la cour féodale de Cassel avec ses privilèges. Sa justice était rendue par le haut justicier choisi par le comte dans un des lieux qui jouissaient du droit de haute justice, comme Estaires, entre autres. En 1674, le prince Eugène de Montmorency était haut justicier.
En 1680, le magistrat d’Estaires était composé de :
Le sieur Le Brun ch., avoué, et Henri Béghin, Bartholomé Theeten, Me Florent Ratfel, H. Le Lièvre, docteur, Pierre Mathelin, échevins ; Paul Boucher, leur confrère étant mort
On proposait les noms suivants capables de remplir la place de ceux qui seraient changés : les sieurs André Hecquin, Jean Le Brun, Gille de Heerscher, Antoine Vaast, Ch. Hamelin, Hugues de Marles, Paul-François Boucher, Paul Desplanques.
Le résultat fut la nomination de André Hecquin (ou Verquin), avoué ; les sieurs Le Brun, H. Béghin, N. Lelièvre, J. Le Brun, G. de Heerscher, et P.-Fr. Boucher, échevins... « ordonnant au sieur Lamys Sébastien, notre grand bailli, de les prendre en serment en la forme ordinaire, pourveu que le pasteur dudict Estaires n’ait rien à reprocher sur leur foi et manière de vivre. » A Estaires, le 10 décembre 1680. Signé : Montmorency, prince de Robecq.
En août 1692, un édit royal crée à Estaires un conseiller du roi, un maire, un assesseur commissaire aux revues et logement des gens de guerre, et le magistrat avance au roi 1,540 florins pour que ces charges soient réunies au corps de la ville. Peu à peu le pouvoir royal absorbera tous les droits des seigneurs et leurs anciennes prérogatives et celles des communes, jusqu’au jour ou le tiers-état déclarera que c’est à lui à être tout parce qu’il est le nombre, et parce qu’il aura appris de Voltaire et Rousseau et consorts à repousser l’autorité, en niant les droits de Dieu, source de tous les autres : « Plus de maître, le peuple est souverain. »
Mais nous anticipons.
La maladrerie est vendue, en 1693, à l’administration des pauvres, et sont créées quatre charges de brasseurs à 2000 livres. Un arrêt du 1er décembre confère le privilège à quatre brasseurs.
En août 1695, création d’un contrôleur commissaire du roi, vérificateur de la recette et dépense du trésor. pour 550 livres. J.-B. Cambier, greffier du magistrat d’Ypres, achète cette charge l’année suivante.
La ville achète le vierscaere du Zuit-Berquin pour 65 livres de gros, rente de 108 florins, sur le quartier de la Basse-Boulogne.
Le Conseil d’État confirme, par un arrêt du 4 juin 1703, l’accord qui était fait entre Merville, d’une part, et Bailleul et Estaires, d’autre part, relativement au droit d’issue attaché à la bourgeoisie de ces deux villes.
Le roi maintient les magistrats de Bailleul et d’Estaires
dans leur droit de connaître des maisons mortuaires de leurs bourgeois
inscripts, quoique demeurant à Merville, et les échevins de Merville auront le
même privilège pour leurs bourgeois demeurant dans les deux dites villes. Les
uns et les autres bourgeois demeurant dans ces villes autres que les leurs n’auront
pas à payer de droit d’issue ni autre. L’accord disait :
|
1° Les magistrats de Merville n’accepteront dans leur bourgeoisie aucun bourgeois de Bailleul ni d’Estaires et réciproquement. 2° Les bourgeois de Merville passeront d’une bourgeoisie dans l’autre sans payer droit d’issue, mais ils le payeraient pour entrer dans une autre bourgeoisie que celle de Bailleul ou d’Estaires avec lettres du magistrat de Merville ; sinon ils payeraient droit d’écart à Bailleul, et en cas que les magistrats de Merville déclareraient par lettres ceux qui, anciens bourgeois de Merville, et, avant, de Bailleul, prendraient une autre bourgeoisie. 3° Réciproquement il n’y aura pas de droit d’issue ou d’écart pour les biens meubles ou immeubles échus aux bourgeois de chacune de leurs juridictions. 4° En cas de mariage, la fille suivra la condition du mari, si la bourgeoisie de Merville s’étend hors du territoire, autrement resteront bourgeois de Bailleul (ou d’Estaires). |
Le 27 mars 1710, une taxe d’un patar par lot de vin et de 12 par tonne de forte bière est imposée pour subvenir aux arrérages. Les incursions des ennemis avaient causé de grandes pertes à la ville. Le 20 novembre, le magistrat reçoit ordre du prince d’Orange de rétablir le pont « sous peine qu’on le fera faire à leurs dépens. »
En 1713, une indemnité de 5000 livres faisant 8400 livres parisis est accordée le 3 mars par préciput à Estaires sur les 74,372 livres 2 sous 7 deniers accordées à la châtellenie de Cassel en dédommagement des pertes essuyées en 1708; nonobstant la cour de Cassel qui s’oppose à cette décision, l’intendant Le Blanc ordonne que les branches de la généralité d’Estaires au pouvoir de l’ennemi n’ont point part à l’indemnité.
La ville doit par an, de frais extraordinaires, environ 6000 florins.
Une décision est prise le 8 novembre 1715 sur les rangs à tenir à la procession pour les gens des branches étrangères à la ville et condamnée par la cour d’Ypres le 22 mars suivant. On sait que les processions de ce temps-là étaient souvent matière à querelles entre les officiers, ecclésiastiques ou civils pour le rang que chacun y avait à tenir. Tout le monde y figurait, et certes, c’était un spectacle édifiant et profondément suggestif que de voir la société tout entière escorter par honneur le Seigneur des seigneurs ; mais encore fallait-il que l’étiquette fût conservée et que les dignités se vissent respectivement honorées en raison de leur importance. Nous avons assisté à ce spectacle.
A cette date, 1716-1718, outre les travaux de l’église, on s’occupait aussi de l’hôtel de ville et de classes latines. Ceux entrepris pour la maison de ville montaient à 77 florins. Estaires avait à payer aussi, par décision de l’intendant Barentin, 131 florins 11 patars 6 deniers, pour une moitié employées, croyons-nous, dans la ville, qui les imposait à son profit.
Le 12 avril 1718, les biens d’octroi sont 3,278 florins 10 patars, des tuiles, et le 19 juin, le budjet des dépenses : 4,012 florins 15 patars 9 deniers.
Le total des biens patrimoniaux, c’est-à-dire le louage de l’hôtel de ville et autres: maisons, en 1722, montait à 348 florins 10 patars, la ville profitant aussi des droits d’écart et d’issue de ceux qui rachetaient leur bourgeoisie ou y renonçaient, en vendant des héritages situés dans la ville, mais ces droits n’avaient rien de bien déterminé (généralement un dixième des biens.). Le paiement des tuiles pour 1721 porte 1,753 florins 14 patars 7 deniers; les réparations à l’hôtel de ville : 497 florins 18 patars. Ainsi les dépenses excédaient. L’acte est signé par : Sébastien-Pierre Maniez, Pierre-Augustre Le Saffre, Hamelin, R. Van Tourou, P.-A. Rogeau, N. Chavatte, J.B. Béghin. Le revenu des octrois de 1718 était de 1,273 florins 10 patars; en 1721, de 3,694 florins 17 patars 9 deniers. La dépense de cette même année s’est élevée à 7,795 florins 4 patars 10 deniers.
En 1728, par acte du 24 février, la maladrerie est unie à l’hospice, par suite de la requête du prince, approuvée par les sept branches de la communauté et paroisse, dont deux sont sous la domination de l’empereur.
Le Conseil d’État exempte, le 14 mars 1761, du don gratuit extraordinaire les villes de la Flandre maritime moyennant paiement de 283,500 livres à effectuer par ces villes. En conséquence elles pourront percevoir un impôt par-dessus les autres octrois. Dans la ville d’Estaires, dépendances et étendue d’une lieue de distance : six patars par pot d’eau-de-vie consommée chez les cabaretiers, trois patars par tonne de bière consommée chez les bourgeois.
L’état civil d’Estaires était, en 1774, composé de :
|
MM. Harduin, bailli; Gadelin, lieutenant-bailli. Échevins : MM. Duflos, avoué; Le Brun, d’Hennin, Mille, Charles, Le Tellier, Béghin, greffier; Rollin, trésorier; Sinoquel, clerc de loi. MAGISTRAT Arrière ban de sept jurés :Avocats : MM. Theeten, écuyer, seigneur de Beautour, etc.,P.-F. Béghin Notaires : Béghin, notaire royal, et Esteelandre En 1783, grand bailli : Harduin; D. Monet, lieutenant-bailli. Échevins : MM. L. Vaast, avoué; J.-J. Dengremont, E. Liénart, Ch.-F. Couvillon, G.-J. Meurillon, P.-F. Fauconnier, G. Duflos. Conseillers : MM. Coustenoble, Jacquin, Garcette, Gamelin, (Gadelin) fils ; Lingrel, Gruson, Théry. Partageurs jurés de ladite ville et bourgeoisie : MM. Vermesch, G. Béghin, J.-L. de Cleene, J.-N. Garcette. Procureurs : MM. Esteelandre, notaire ; G. Béghin, notaire ; J.-N. Garcette, A. Béghin, De Grave, Baudelet, P.-Fr.-J. Pétillon, D. Monet. Chirurgiens : MM. Dengremont et A. Béghin. Quatre sergents et vingt-six portefaits pour assister le bailli, En 1784, M. J.-L. de Cleene est greffier, civil et criminel, de la bourgeoisie. En 1787, échevins : J. Le Brun, M.-F. Gadelin, P.-A. Le Gillon, L.-J. Duflos, A.-F. Le Comte, A. de Rensy, J.-F. Revel. Médecins: MM. Prevost et Le Febure. Receveur des domaines du Roy : A. Rodier de Mont-Louis. En 1789, avoué : Le Brun. Échevins : M.-J. Gadelin, L.-J. Duflos, A.-F.-M. Le Comte, P. Pétillon, F. Butry, E. Ridez. Conseillers : P.-F. Coustenoble, P.-F. Jacquin, P.-B. Gadelin, L. Claris, A.-F. Warembourg, J.-B. Hennion, Lecoeuche. Trésorier : M.-F. Dassonville. Notaires : P.-A.-M. Marchand et Esteelandre. Manbourg des pauvres : Le sieur Marc Dilly. Chirurgien : A. Salmon. Sergents : Daisnes, J.-B. Verhaegues, J.-B. Haverlant, Borbet.
L’état civil d’Estaires, en 1791, était :Maire : M. Charles. 338 citoyens actifs. Officiers municipaux : MM. Rollin, J.-J. Dengremont, S.-C. Pouvillon, L. Vaast, A. Vermesch. Procureur de la commune : M.-J.-L. Fauconnier. Secrétaire greffier : Decleene. Trésorier : M.-M.-J. Dassonville. Notables : MM. Duflos, J.-B. Ridez, G. Dehaisnes, N. de Lescoeuillerie, P.-C. Trinel, A. Béghin, L. Duflos, J,-B. Lesage, M.-P. Dilly, E. Ridez, P.-A. Hameau, J. Revel. Juge de paix : M.-J.-L. Decleene. Notaire : M. P.-A.-M. Marchand. Tabellion : A.-J. Esteelandre. Commandant de la Garde nationale : M. J.-B.-J. Lesage. La Foire de toiles : 22 juillet et 28 octobre. Franc marché : troisième jeudi du mois. Marché tous les jeudis. Courrier de la poste, chaque jour pour Saint-Venant. Messagers, deux fois la semaine, pour Lille, Béthune, Bailleul ; une fois pour Aire. Voiture d’eau, chaque jour, pour le Pont-Neuf, près d’Armentières. Vierschaere d’Estaires : 167 citoyens actifs. Juge de paix du canton : Cattoir.
Dépendances de la paroisse d’Estaires :Pont d’Estaires : Maire, Westeen ; 164 citoyens actifs. Watreliet : 54 citoyens actifs. Doulieu : 81 citoyens actifs.
Élections aux États-générauxAvec le comte d’Estaires à l’assemblée réunie en mars 1787 à Bailleul pour les élections aux États-généraux, convoqués en 1789, d’Estaires on voit MM. Ch. Hadou, Fauconnier, L. Charles, Pierre d’Hennin, Aug. Vermesch, Louis Théry, Pierre Marchand, notaire. Pour le pont d’Estaires : P. Petitprez, Al. Laignel. |