Les Comtes de Flandre (... - 1384)
Le comte de Flandre Bauduin, ayant repris, en 1197, au roi de France quelques villes d’Artois et « exislé par feu et par espée tout le pays, » s’avança jusqu’à Steenwoorde, où, entouré de Flamands et la retraite lui étant coupée, il vint « avec ses ost » à Bailleul, où il se vit obligé de signer un traité par lequel Bauduin acquérait la souveraineté sur Richebourg, La Gorgue et les possessions de Guillaume II de Béthune au delà de Neuf-Fossé.
Après Bouvines, 27 juillet 1213, le roi se considère comme seigneur de Flandre.
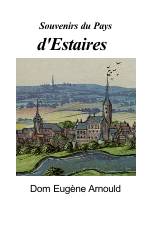
Le comte Ferrand reprend Ypres en 1213, et, après avoir assiégé le château d’Erquinghem, s’empare de Lille. Au printemps, le roi de France reprend Lille et ruine Erquinghem et Cassel. Hugues de Bailleul est chargé de défendre le pont d’Estaires.
Tandis que Philippe-Auguste combattait les Anglais dans l’Anjou, son fils Louis portait la dévastation dans Bailleul et le val de Cassel, en 1214. Henri de Bailleul envahit l’Artois, d’où il est repoussé par le vicomte de Melun.
En 1297, les Français assiègent Lille et étendent leurs ravages sur les bords de la Lys. Les d’Haveskerques sont Léliarts.(partisans du lis , c'est à dire du roi de France )
L’or du roi de France et les défaites du comte Gui de Dampierre avaient gagné à Philippe le Bel le parti des Léliarts, qui fera bientôt ouvertement défection au comte de Flandre.
On trouve les personnages suivants qui tenaient avec Philippe le Bel.
En Vies-Berkin :Mésire Wautiers de l’Escaghe, |
En Nuef-Berkin :Jehan Lamp, En Estaires :Jakemes d’Astices, |
Le Jubilé accordé par le Pape en l’an 1300 excita un
immense enthousiasme mais n’arrêta pas toutes guerres.
L'abbesse de Beaupré s’adresse à cette date au prévôt de St-Barthélémy, réclamant la sauvegarde du comte de Flandres par son entremise: « esmues de le grant plente de gens ki dist ki (les Français) viennent et ayant très grant peur de fu et de reube.(pillage) »
Le sire de Vuallepaye, que Robert d’Artois avait fait gouverneur de Furnes s’en vint, en 1302, à Cassel, et établit dans le château abandonné Jean et Gilles d’Haveskerque. Les deux frères repoussèrent Guillaume de Juillers « qui commence à faire grands assaux, et ceux de dedans se défendirent comme bonnes gens. »
Les églises de Flandre étaient fortifiées. De nouveau repoussés de Cassel, les Flamands viennent à Terrouenne qu’ils brûlent, passent à Pont-à-Vendin, après avoir tenté un assaut contre Saint-Omer, où Jean de Haveskerque, seigneur de Watenes; défendit la porte de l’Eau vers Gravelines.
L’année suivante, à la paix, juin 1304, Lille, Douai, Cassel, Courtray, Armentibres et La Bassée sont engagés au roi.
Les Français ravagent le pays de Cassel en 1316. « Philippe, régent, commanda qu’ils feissent le pis qu’ils pouvaient, et si firent-ils, car ils ne finirent d’ardoir et et d’exiler le païs de Cassel et environ. »
Jusqu’en 1320, Estaires, le château de Nieppe et tout le pays jusqu’à la mer sont donnés à Robert, second fils du comte Robert et seigneur de Cassel et Warneton. En 1324, Cassel, Bailleul et les communes voisines ouvrent leurs portes aux Flamands révoltés commandés par Zannequin. Robert de Flandre, de son château de Nieppe, entretenait les troubles. Un instant il est gouverneur ou rewart pendant que le comte Louis de Nevers était prisonnier des Brugeois. Celui-ci assiste ensuite au sacre de Philippe VI, qui vient à son secours, ravage le pays d’Aire à Cassel, où il gagne une grande bataille. Des 16,000 flamands qui périssent, pas un ne demande quartier, dit Froissard (1326).
Les hommes du pays de Cassel vont, en 1328, à la défense de Tournay, et les d’Haveskerque soutenaient le roi.
L’industrie flamande, souffrant de ce que le comte soutenait le roi de France contre l’Angleterre, Jacgues d’Artevelde est proclamé rewart par les communes. Il s’allie aux Anglais, visite Cassel et autres villes du pays qui lui ouvrent leurs portes et lui font soumission. Cependant Estaires, relevant des d’Haveskerque, n’a pas dû embrasser la cause de d’Artevelde ; aussi la ville est-elle incendiée par les Anglais.
Les habitants d’Ypres enlèvent Armentières, en 1339, aux Génois stipendiés de Philippe VI. L’année suivante, les Flamands commandés par Robert d’Artois sont repoussés de Saint-Omer. Le roi occupe Aire et Saint-Venant. Sous la conduite de Jacques d’Artevelde, les Gantois révoltés avaient salué roi de France Édouard III d’Angleterre, qui comptait dans ses alliés Robert d’Artois et Henri de Flandre.
En 1340, Robert d’Artois essuie un échec à St-Omer. Philippe de Valois, étant à Aire, fait une seconde fois piller le val de Cassel.
En 1346, 600 archers anglais débarquent en Flandre. Les milices communales s’arment sous les ordres de Henri de Flandre. Repoussées au Pont d’Estaires par les Français, elles passent la Lys à Merville. Louis de Nevers meurt à Crécy; Louis de Mâle, son fils, est comte de Flandre. Le roi de France propose une paix avantageuse aux communes qui refusent. Les bords de la Lys sont dévastés par les Français qui traversent la rivière à Estaires, mais bientôt se voient embourbés dans des chemins fangeux, attaqués par les manants et réduits à la retraite. En 1346, les Flamands soumettent le pays de Leubbe et assiègent Béthune. Jean de Ghistelles, grand oncle du seigneur d’Estaires, Philippe de Haveskerque, est tué à Crécy.
L’année suivante, 1347, Estaires est brûlée par les Flamands. Ils sont battus au Quesnoy par Charles de Montmorency, gouverneur de Picardie et d’Artois. Dix mille Français battent près d’Estaires douze cents sergents de la Leubbe et sont repoussés de Cassel, dont ils ravagent les environs. Toute la Flandre, excepté Lille, avait partagé la révolte des Gantois. Après la défaite de l’insurrection, les villes d’Ypres, Cassel, etc., se soumettent à Charles VI.
Après les ravages de la peste noire en 1348, on voit dans la châtellenie de Cassel se former des associations de flagellants, d’abord pieuses mais qui dégénérèrent ensuite.
Le comte Louis se fait indemniser, en 1360, par les châtellenies de Cassel, Bailleul et Warneton, de ses frais de voyage en Angleterre.
le comte Louis de Mâle, meurt à St-Bertin
la Flandre passe à son gendre le duc de Bourgogne. (1384)
La cause communale succombe en 1382 à Roosbèke, où 40,000 hommes restent sur le champ de bataille. L’année suivante, le dernier descendant de Bauduin bras-de-fer, le comte Louis de Mâle, meurt à St-Bertin, laissant la Flandre à son gendre le duc de Bourgogne. Cependant la guerre de Flandre était devenue comme une croisade contre les partisans du Pape Clément en faveur de Urbain VI. L’évêque de Norwich commandait lui-même 900 lances. Il s’avança, en juin 1383, contre les Flamands chez lesquels le duc de Bourgogne avait laissé quelques garnisons françaises. Jean de Vienne, amiral de France, sous les ordres de qui sert Henri d’Antoing, défend la frontière avec 600 lances. « Les Anglais pillèrent et volèrent les villes, et rançonnèrent et occirent les Flamands. » (Chronique de Flandre.)
De nouveau Estaires fut livrée aux flammes. Une expédition se préparant contre l’Angleterre, les pays voisins de Flandre sont envahis par de nombreuses bandes d’aventuriers qui les mettent au pillage. Jean de Haveskerque, prisonnier des Anglais, se vit obligé de vendre à sa tante Marie de Haveskerque sa seigneurie d’Estaires.
En 1384, Charles VI abandonne la Flandre sans l’avoir pu soumettre.
Estaires, sur les frontières des pays wallons et flamands, devait souffrir quelquefois de sa situation.
En 1367, s’était livrée une bataille à Laventie entre Français et Flamands. Les querelles de la famille d’Englos, de la châtellenie de Lille, avec la famille de Neuve-Église, de la châtellenie de Bailleul, venaient compliquer la situation. Du temps de Louis de Mâle, Jean d’Englos avait été banni de Flandre pour meurtres contre les Neuve-Église. Quelques temps avant Roosbèke, Jacques de Neuve-Église attaqua le comte de Flandre dont les désordres avaient lassé la patience. ll tua Jean d’Englos et fit périr son père Bernard d’Englos au Pont d’Estaires, puis Mahieu de Castrique, à Steenwerck.
Pour se purger de ce dernier crime, les meurtriers se mirent en
loi à la Gorgue. Ils furent accusés par Marie d’Englos, mais on l’obligea
à se désister de ses plaintes. En 1388, nouveau combat entre Wallons et
Flamands à la porte de l’église de la Gorgue. Le bâtard de Neuve-Église
étant venu à passer avec une troupe de Flamands, une provocation de ceux-ci
adressée à Jean le Grard, tous les gens de l’Aleu
|
«courent aussitôt sur lesdits Flamens, en frappant de kaismaulx et plonçons et de glaives ceulx qu’ils povoient advenir, et les autres de trais d’arcs et d’arballeste, tellement qu’il y eut desdits Flamens grant quantités de plagés et de navrés.... et là fut ledit bastard navré (blessé) tellement que mors sen ensuy en sa personne. » (Yolande de Flandre, – De Smytter, p. 97.) |
Rien de plus piquant que la révision des comptes de Guil. Suryen, bailli de Merville pour le comte de Flandre durant les troubles des Gantois auxquels avaient pris part quantité de Mervillois. Estaires ne semble pas y avoir eu de rôle aussi actif. Entre autres méfaits, Suryen avait enlevé en Robermès 100 mancaux de blé, lesquels furent chariés en la grange de la Morianne.
Parmi les témoins déposant contre les conspirateurs et révoltés figuraient Jean de le Val, bailli de Mme Vve Pierre de Bailleul en Robermès, Porrin du Werchin, etc.
Parmi les révoltés, en Robertmez dessous Monsigr Pierron de
Bailleul.
Vivants : P. et W. Wite, Vinchent le Cambrelenck, Jehan Glose.
Noyet : P. du Ployeek.
Tués : J. Taillemonde, J. Leurent et G. Hubert du Brequin.
Coppé le tieste : Jean d’Estanghem qui fu capitaine du Pont d’Estaires.
(Arch. du Nord. Information à Merville en 1385.)
En 1403, Estaires est encore incendiée. De tel désastres arrivaient fréquemment, parce que les maisons étaient généralement construites en bois et couvertes en chaume, et parce que les rues n’étant pas éclairées la nuit, chacun sortait portant torche ou lanterne.
La révolte de la châtellenie de Cassel contre le bailli Guillaume de la Clyte, en 1427, est apaisée par Philippe le Bon, en 1431 ; mais des difficultés subsistant encore, l’insurrection continue et cause des troubles dans plusieurs villes, « aucuns avec bastons ou aultres armures attaquent, battent, navrent, reubent, pillent plusieurs bonnes gens. » Ainsi en allait-il à Merville par « la malvaistié » des villes voisines.
Ne peut-on pas sous entendre Estaires quelque peu piquée peut-être des privilèges de cette cité ? Le duc Philippe le Bon avait, en effet, octroyé des privilèges aux drapiers de Merville, en 1427 et 1431. Après la rébellion, les habitants de la châtellenie de Cassel durent payer 40,000 roubles au duc et 10,000 à Colard de Commines, bailli.
Estaires est, en 1474, la proie d’un incendie qui dévore toute la ville sans épargner une seule maison. Avant ce désastre, on y comptait 874 métiers de tisserand. Toutes les chartes de la ville furent brûlées. Maximilien, à quelque temps de là, prend Saint-Venant.
Louis XI avait fait des levées de faucheurs en Picardie pour ravager l’Artois et la Flandre. Ils ne laissèrent rien jusqu’à Ypres des riches moissons qui couvraient la contrée. Le roi Louis XI passe la Lys en 1478, brûle Bailleul, mais se voit près de ne pouvoir opérer sa retraite, les gens de Flandre, comme en 1197, détruisant les ponts et barrant les chemins. Il se voit obligé de se replier sur Arras. Après Guinegatte, le pays est complètement dévasté. Béthune s’était rendue. Aire était tombée aux mains du sire de Crèvecoeur, le 26 juillet 1482. Lors du traité de paix, les villes et villages voisins furent exemptés d’impôts et arrérages pour six années.
En 1513, Terrouenne, la vieille capitale des Morins, est détruite par Henri VIII.
La domination espagnole (1526-1679)
En 1531, Charles-Quint passa la Lys à Estaires après une victoire sur les Français. Il fut reçu par 9,000 hommes en armes de la ville et des environs, et « qui effacèrent tous les habitants des bords de la Lys, » outre les trois compagnies d’archers favorisées, « lesquelles doivent servir le seigneur du pays et à son départ l’escorter jusqu’à la prochaine. »
Les Français s’emparent, en 1536, de Hesdin, Lillers, Saint-Pol et Saint-Venant. Le comte de Roeulx réunit à Minariacum 4 000 fantassins et 600 chevaliers. Ils suffirent pour arrêter l’invasion française qui se replia sur Doullens. Le comte de Roeulx reprit l’offensive en 1537, et, cette année, la paix fut signée à Bomy. (Kervyn de Littenhove.)
Henri VIII prend Boulogne en 1544. Une partie des habitants vont se fixer à Terrouenne, et probablement font appeler près de cette ville un village "Basse-Boulogne", ainsi que des quartiers d’Estaires et de Merville. En 1558, Terrouenne est rasée, détruite pour ne plus se rétablir : "DELETIS MORINIS". C’en est fait à jamais de cette ville antique des Morins, "multos dominata per annos".
En 1564, « après des mesures de rivalités qui affaiblissent dans la Flandre » les manufactures de rubans, épingles, etc., la liberté mutuelle est rétablie entre la Flandre et l’Angleterre.
Les Gueux ( 1566-1568 )
Les causes qui firent se répandre facilement le calvinisme dans nos régions, étaient l’intérêt politique et industriel.
En relations commerciales depuis toujours avec l’Angleterre, la Flandre ne laissait pas d’avoir les bonnes qualités de son alliée. D’autre part elle supportait à contrecœur le joug de Philippe II. « L’Allemagne, aujourd’hui unie à l’Italie contre la France , est opposée à l’Italie de mœurs et de génie. Cette dernière, à l’époque de la Renaissance, non moins corrompue que son alliée, fut préservée du schisme par le Pape et l’inquisition, quand la nation tudesque, personnifiée dans Luther, se levait contre l’Église romaine.
Cette native antipathie pour la péninsule jointe à la licence et à l’intérêt groupa les Allemands autour de leur docteur révolté. Henri VIII se faisait le pape des Anglais. Calvin gagnait à sa doctrine la Suisse et nos Flandres ; mais, grâce à la main vigoureuse de l’Espagne, nos populations redeviendront bientôt catholiques » : service inoubliable de la domination espagnole !
Les Huguenots nous montrent le navrant spectacle de nombreux religieux apostats.
« Voir Le Mont des Cattes, 1898 : « Des ministres venus de Frise faisaient la propagande au Doulieu, à Steenwerck, etc.; entre ceux qui les aidaient se voyaient de Swarte, ancien dominicain ; Michel Van Eyde, dit le moine ; Guil. Damman, de Boeschèpe, prêtre; Jacgues Dathemis, jacobin d’Ypres, etc. »
La grande Révolution verra aussi plus de moines partisans de ses excès que de prêtres séculiers. D’où vient cela ? nous savons seulement que la corruption des meilleurs est la pire, et nous espérons que semblables événements ne ramèneraient plus mêmes résultats. (Voir Révolution : les trois curés d’Estaires assermentés.)
L’année 1565 avait eu un hiver très rigoureux, et Estaires dut s’approvisionner de grains à Gand, pour revendre à moindre prix. A cette époque, des conciliabules avaient lieu dans Estaires et environs, et dans des comédies, organisées par des gens de Lalleu et autres, le catholicisme était bafoué.
En 1566, paraît dans ces régions Jean le Sauvage, seigneur d’Escobèque et Ligny. Les calvinistes de Merville, Estaires et Lalleu se portèrent en masse pour le secourir quand on voulait l’arrêter dans son château de Ligny. Philippe, seigneur de Bailleul aux Cornailles; Eustache de Fiennes, seigneur d’Esquerdes ; Charles de Langastre, Adrien de Bergues, seigneur d’Olhain; Jacques de Rosimbos, fils de Pierre, chambellan de Charles-Quint ; Jean d’Estournel, seigneur de Vendeville au château du Doulieu, agitaient le pays d’Estaires, surtout le fameux Henri de Nédonchel, plus connu sous le nom de Honnecamp.
Armentières, Estaires, Laventie, La Gorgue avaient des temples et des prédicants pleins de fougue. Aussi des désordres ne tardèrent pas à se manifester : rébellions, pillages, meurtres, incendies. Les environs de l’abbaye de Beaupré avaient, en juin 1566, des réunions de plus de deux mille personnes diversement armées assistant à des prêches. Un des plus zélés sectaires était Le Josne d’Estaires. Après le sermon, il y avait quête pour les pauvres et chant de psaumes en français.
A Estaires, Jacques Bécue et Jean Pelizère étaient décorés du titre d’anciens. Fr. Revel était diacre, Regnault Le Roy, sous-diacre, et Gille Houcke, bailli des gueux. Noël Creton et Fr. Revel étaient collecteurs des annonces faites dans les temples d’Armentières, Estaires, Richebourg, Laventie, La Gorgue et Merville.
A Estaires, la société des arbalétriers se trouvait presque tout entière calviniste, ayant à sa tête pour roi : Mathieu Chavatte. Le magistrat lui-même était sectaire ; aussi les réunions protestantes se faisaient-elles en plein jour, assurées de l’impunité. Après de furieuses excitations dans des prédications à Ypres et Saint-Omer et partout, notamment à Estaires, par Julien et. Jacques de Buyser, on pilla les églises.
Celle de la paroisse et des Sœurs grises d’Estaires furent entièrement dévastées. De là les bandits allèrent ravager l’abbaye de Beaupré.
C’était le 15 août 1566. Le 18, mourait l’aumônier D. Éloi Serpet. Le 29, quand sa tombe était encore fraîche, après avoir tout pillé, les huguenots déterrent le cadavre, le traînent dans les cloîtres, puis l’attachent à un sapin du préau, le flagellent et ensuite le jettent sur un monceau formé de tous les objets du culte et réduisent le tout en cendre. (Hist. de Beaupré.)
A Estaires, le 15 août, Julien avait prêché en français. Sur le marché, de Buyser prêche en flamand; le seigneur de Vendeville est présent, entouré de hallebardiers et enrôlant des hommes sur l’ordre du prince de Nassau.
Le Josne, hôtelier des Trois-Rois, régale les pillards de tonneaux de bière. Avec les verrières, autels et statues de l’église paroissiale furent démolis les tombeaux des seigneurs d’Isenghien et de Glayon. Mathieu de Bourges, échevin, payait le guet qui se faisait chaque nuit devant le château d’Estaires.
L’église fut restaurée, mais derechef dévastée. Quand on ouvrit le temple à Estaires, le seigneur de Longastre et cinq ou six autres dont Philippe de Bailleul, dit le gentilhomme boiteux, ouïrent le prêche; puis, en agitant leurs gants, crièrent sur la place : « Vive les gueux ! » et, faisant sonner de la trompette, ils prirent le chemin de Merville.
Le 10 septembre, les protestants commirent de nouveaux actes de vandalisme à Estaires.
La duchesse de Parme, ayant autorisé les calvinistes à prêcher en public, ils exercèrent dès lors leur culte ostensiblement partout, chassant les prêtres et s’emparant des églises. On dut entrer en pourparler avec les chefs, et le duc d’Egmont s’entendit avec le seigneur d’Escobèque à cet égard.
Cependant les confédérés ayant résolu de s’emparer de Tournay, les seigneurs d’Escobèque, de Vendeville et de Noyelles firent des enrôlements à Estaires, où nombre de paysans se laissèrent embaucher croyant servir le roi.
Le mardi matin avant Noël 1566, M. Lescaillet, après plusieurs prières récitées au temple nouvellement bâti et remplaçant les demeures de Fr. Le Candele et de l’hôtelier Jacques Le Moor, premiers témoins de ses prédications, parla du meurtre du ministre d’Ypres; Il faut aller le venger et délivrer les frères prisonniers. Aussitôt Thomas Le Moor sonne du tambourin; Michel du Riez, censier du Marais, les Le Moor, Olivier Le Brun, Robert Descamps, les deux fils du Ploic, Adrien Chiroutre, Nicaise Laurent et les autres sectaires marchent tous armés d’arquebuses et d’épées, de faulx et de toutes sortes d’armes.
A Estaires, ils rencontrèrent à l’auberge des Trois-Rois le capitaine Reumault-Thérier, reconnaissable à son visage balafré, et un autre chef. Le tambourin d’Henri Le Secq, par ordre des Wattepatte, se faisait entendre dans La Ventie depuis deux heures du matin. La troupe s’y grossit de tous !es sectaires, Octavien Bécourt et les Wattepatte à leur tête, avec les de Hem, de Le Becque, G. de Waxembourg, les deux Denain, Le Rossignol, de Richebourg, à cheval, visière haussée, faisant le rôle de capitaine.
Sailly fournit son contingent. On arrive à Armentières, où l’on ne trouve pas les seigneurs qui devaient s’y rencontrer. Alors ceux qui ne rebroussèrent pas chemin allèrent à Tournay, où tout se borna à mettre le feu à l’abbaye Saint-Nicolas. En revenant, les gueux se firent battre à Wattreloos et à Lannoy, où Le Rossignol trouva la mort.
On songeait, à Estaires, à se défendre contre ces exaltés. Le seigneur Floris de Stavèle s’adressa aux magistrats des villes voisines pour aviser aux moyens de se protéger, et l’on commença à élever des barrières et des portes. On trouve à cette date mentionnée la rue des Ribauds. Le roi autorisa, le 6 mai 1567, Estaires à lever 6 deniers tournois sur le débit de chaque lot de vin ou tonneau de cervoise, et un sol tournois sur chague tonneau de bière double, pour solder un arriéré de 1,000 livres, 40 gros, et achever les chaussées et portes.
Les Espagnols sévissaient activement. Le conseil de Flandre condamnait, le 21 novembre 1567, le seigneur de Vendeville à cinquante ans de bannissement et à la confiscation de ses biens.
Le conseil des troubles condamnait, le 29 mars de l’année suivante, au bannissement perpétuel et confiscation des biens, les Estairois qui suivent : Antoine du Bois, Antoine Rembly, Antoine Chavatte et Antoinette Wattelier sa femme, Antoine Six, François Keerle, François Rogere et Barbe Galant sa femme, Fr. Pieters, Fr. et Robert du Puichs frères, Guil. Rembly, Gille Houcket et Jacquemine Le Secq sa femme, Jacques Bécue, Jean du Bois, Jean Le Mire, Jean Marchand, Louis Faulconnier, Rénault Le Roy et Anna Wautier sa femme, Sandrine Le Secq, Yvon Caudron et Marcq Tassel, pour bris d’images dans l’église d’Estaires et autres.
Fr. Revel a recueilli de l’argent pour obtenir la liberté de conscience et l’a porté à Anvers ; Mathieu de Bourges a quêté dans le temple; Jean du Camp fut lié intimement avec les chefs et prédicants, et tous les susdits se sont armés pour aller à Watreloos ; Jean d’Oultrel’Eaul et Noël de Bestere ont été ministres ; Peronne Capelan a fréquenté les prêches.
Le 12 janvier, les habitants d’Estaires avaient reçu l’ordre d’indemniser le clergé et de répondre de sa vie.
Le 30 mars 1568, furent condamnés par contumace : Philippe de
Villers, qui s’était rendu à Estaires et à Furnes pour y délivrer des
prisonniers ; le 13 avril, Jean Sauvage, seigneur d’Escobèque, avec nombreux
calvinistes de Ligny et d’Armentières.
Le 28 mai, le conseil des troubles condamne Jean Reumault :
1° à avoir le poing droit et la langue coupés pour s’être livré à des
actes de blasphèmes contre la religion;
2° à être exécuté par l’épée avec confiscation de ses biens pour avoir,
sur l’ordre du seigneur d’Escobèque, été avec Robert Terre au pays de
Lalleu pour lever des gens, et de là les conduire contre Sa Majesté;
3° pour avoir été avec les rebelles à Viane, sous Maximilien de Blois, dont
il a été lieutenant, etc.
Cornil du Moulin et Mathieu Herman d’Estaires sont condamnés, le 10 juin, pour s’être mis à la tête des sectaires qui ont pillé l’église, le 15 août 1566, et avoir introduit par force la nouvelle religion à Zuit-Berquin, avoir été à Tournay, etc....
Le même 10 juin 1568, le bailli, les hommes de fief de la baronnie d’Haverskerque, les avoués et échevins d’Estaires déclarent que Cornil du Moulin et Mathieu Herman ont été exécutés par l’épée, s’étant réconciliés avec la religion catholique ; et Charles Bécue par la corde, ayant refusé de se convertir.
Le Josne fut condamné à être exécuté par l’épée, le 26 juillet 1568, avec Adrien Grincourt, qui avait hanté les prêches de Merville, Estaires et La Gorgue et était allé au Quesnoy combattre Sa Majesté.
Le 17 août, furent bannis les seigneurs Philippe de Bailleul, Charles de Houchy, Adrien de Bergues, Eustache de Fiennes seigneur d’Esquerdes, et Guil. de Fiennes seigneur de Lumbres, Jean d’Ausgue, Jean de Longueval, etc. ; le 12 octobre, Gadifier Lherbier, qui le 10 septembre 1566, avait commis à Estaires « grandes forces et rudesses. » Le 16, Jean de Vos, dit Comophin, Jean de Cerf, Robert le Couturier, Jean de Coustenoble, François Coolen, Nicolas Wechsteen, Alex. Bammer et autres du Pont d’Estaires, et Simon, fils de Jean de Miere, apothicaire, avec Guillaume Montrefin d’Estaires.
On trouve dans un compte de Pierre Van der Mersch, receveur de confiscations, du 7 avril 1567 au 31 décembre 1570, en la série du Pont d’Estaires : François Revel, Fr. Coolen, Gauthier de Swarte, Jean de Pylisère, Philippe Biens et Jeanne Carpentier, Jean de Cherf et une trentaine d’autres, tous bannis, excepté Ch. de Jonghe, exécuté.
Dans le compte de Jean de Vos, même date, pour la châtellenie de Cassel à Estaires : Antoine Rembly, Adrien Grincourt, Antoine Six, Ch. Bécue, Ch. Le Josne, Fr. Revel, les enfants Fr. Piedfort, Jacques Bécue, Jean Pylisère, Jean Rembly, Jean Loreiller, Jean Descamp, Marc Tasseel, fugitif, Regnault Le Roy, Simon Le Myre.
Et quant aux autres fugitifs et habitants ci-déclarés au billet des commissaires, assavoir : Antoine Dubois, Antoine Chavatte, G. Rembly, Ch. Caudron, Vincent Duprez, Fr. et R. Dupuitz, G. de Houck, S. de Miere, Simon Lempereur, Fr. Logere dit Dain et sa femme, Fr. Keecle, Sondrine Le Secq, Noël de Bestère, Jean d’OutreIeaue, ministre, déclarent les échevins n’avoir trouvé aucuns meubles....
Accusés d’avoir favorisé les émeutes, les comtes d’Egmont et de Hornes furent décapités à Bruxelles en 1568. Le gouvernement espagnol continua de prendre toutes les mesures pour combattre les rebelles, et donna ordre aux communes de se défendre contre eux.
Le curé de Richebourg, blessé en 1567 et 1568 par les protestants, est pendu par les gueux des bois en 1570.
En 1577, les huguenots incendient Estaires et l’église est en partie rebâtie. La dame Anne de Pallant s’y construisit un cabinet, dit cabinet madame, derrière l’abside de la chapelle Notre-Dame.
Nous avons cité parmi les seigneurs huguenots le sire de Vendeville, seigneur de Doulieu. Son château était un repaire de sectaires qui de là s’élançaient au sac et au pillage des lieux environnants. En 1570, ils s’en emparent de nouveau et viennent brûler Beaupré dont ils enlèvent sept religieuses, demandant 100 florins de rançon pour chacune.
Mathias d’Autriche, nommé gouverneur des Pays-Bas où le prince d’Orange s’était affermi, se vit réduit à être son greffier. La Flandre et l’Artois s’unissaient à Jean d’Autriche contre l’archiduc Mathias.
En 1578, les nobles, voulant à leurs dépens rétablir l’ordre, forment le parti des malcontents. Les Wallons de ce parti enlevèrent Mme de Glayon, auprès de Lille. Ces soldats, dits du "Pater noster", étaient entretenus par les États. Les États font abattre les châteaux d’Aire, Béthune, etc., la maison de l’évêque d’Ypres; et bientôt, dans la Flandre occidentale, dont la souveraineté était passée aux communes, les églises sont rompues et défaites, et la réforme seule exercée. Les malcontents mettent les villes de Flandre, Poperinghe, Belle, Menin, etc., à contribution et se fortifient dans Cassel. En janvier 1579, ils passent aux royalistes.
Le 29 janvier 1579 a lieu l’union d’Utrecht des cinq provinces. L’Artois, Lille sont au roi ; Ypres signe l’union le 11 juin.
« De 1579 à 1580, dit un chroniqueur, les villages flamands sont déserts, la campagne se change en forêt; les loups et les chiens, pressés par la faim, y promènent par bandes leurs ravages. La peste et la famine font des victimes sans nombre. » Le due d’Alençon prend le titre de comte de Flandre, mais est forcé de se retirer.
Alexandre de Parme, gouverneur des Pays-Bas, accepte, le 12 novembre 1581, l’offre d’une ayde que leur fait Bailleul, moyennant, entre autres conditions, la prompte liquidation de la dépense occasionnée par l’érection de quatre forts sur la rivière de la Lys, portant à la somme de 14,000 florins fournis par Bailleul, « dépens supportés par Estaires et autres lieuz. »
ARCHERS
Nous avons mentionné une compagnie d’arbalétriers à
Estaires. Une autre, d’archers, fut instituée par Anne de Pallant et Floris
de Stavèle, son fils, le 15 juin 1589. Il s’agissait du jeu de l’arc avec
berceaux. Les seigneurs donnent à cet effet la somme de 60 florins « ordonnans
à leur receveur Charles François de la paer, » et les suppliants auront de Sa
Majesté octroi de franchise, « le tout moyennant que les suppliants demeurent
soumis à l’érection d’un autel à l’église de ladicte ville en l’honneur
de Dieu et de Monsieur saint Sébastien. » Les statuts de la confrérie des
archers (1589) méritent d’être ici transcrits :
|
Nul ne pourra tirer « au gardin et berseaulx » que les confrères du Serment de l’arc à la main; si quelqu’un désirait faire partie de la confrérie, après s’être essayé au tir avec les confrères, l’un d’eux le présentera pour la prestation du serment... « et non aultrement sous paine et amende de 5 patars, moitié pour les pauvres, » moitié à ladite confrérie. Ceux qui perdent et ne paient pas sont à l’amende de 12 deniers moitié, etc., comme ci-dessus. « Nuls... ne polront jurer le nom de Dieu ou vains aultres serments » sous la même peine. « Nuls... ne polront jurer ne blasphémer le nom de Dieu ne de parler du diable, bren, gibet... ou aultres vilaines parolles sur paine de 6 deniers ou passer la fossé dudict gardin. » Sous même peine le premier tirant criera : hors. Nul ne fera « reuppes de sa bouche ne aultres infamies, sur péril de chascune fois aller du milieu de l’entrée du berseaulx à deux genoulx et chief nu, baiser la broche dudict berseaulx. » Nul ne dira de paroles injurieuses sous peine de 12 deniers, moitié, etc. Les disputeurs devaient comparaître illico devant les empereurs, roi et connétables de la confrérie, et boire ensemble en paix sous peine d’un patar, moitié aux pauvres, moitié à la confrérie, « et estre puny à la discrétion et volonté desdicts empereurs, etc. » « Item que nulz ny polront juer aux cartes, dez, gaubet, ne aultre jeu sinon de l’arcq à la main... à péril... payer chascune fois 6 deniers au proffict que dessus. » Les confrères, empereur, roi et connétables en tête, iront à l’église « les jours de Monseigneur saint Sébastien, du Saint-Sacrement, et le jour que l’on tirera l’oyselet, » sous peine de 2 gros « à tel prouffict que dessus. » Ceux qui tireront « sans avoir plomb » paieront 12 deniers à la confrérie. La première partie sera de 6 deniers au profit du jardin pour le repas de la confrérie, sur amende de 15 sous. « CHASCUN SE GARDE DE MESPRENDRE..» |
Le 7 avril 1590, le roi d’Espagne approuva la confrérie Saint-Sébastien, à la demande de dame Anne de Pallant, comtesse de Herlies, dame douairière d’Estaires, et messire Floris de Stavèle, comte et seigneur de ces lieux.
Le roi dit que les habitants d’Estaires « archiers en cas de nécessité deffendront la ville, » et veut qu’ils n’admettent dans leurs rangs que « bons catholiques, paisibles et de bonne renommée, ydoine et souffisant pour maintenir ledict jeu de l’arcq à, la main.»
En 1609, le prince de Robecq défend au bailli d’arrêter quelqu’un de la confrérie de Saint-Sébastien, s’engageant à chercher à terminer à l’amiable toutes les affaires.
Les arbalétriers et les canonniers, dont l’hôtel était sur le rivage, devaient avoir de semblables règlements. Toutes ces confréries servaient, à l’occasion, de milice bourgeoise, Elles figuraient dans les cortèges et les cérémonies avec leurs bannières et leurs costumes. C’est ainsi que, lors du passage de Charles-Quint à Estaires, elles effacèrent, par leur bonne tenue, toutes les autres milices des bords de la Lys.
L’année 1624 est marquée par un mal contagieux sévissant surtout sur les pauvres. Philippe IV, roi d’Espagne, à la requête de la ville d’Estaires, épuisée par les aides ordinaires et extraordinaires, l’autorise, par lettres du 27 novembre 1626, à emprunter la somme de 16,840 florins au denier 16 pour secourir les pestiférés indigents.
En 1632, les États dans les provinces espagnoles notent une taxe par tête sur la noblesse et le clergé, pour l’entretien des milices qui doivent remplacer les troupes espagnoles.
En mai et juin, les Hollandais assiégèrent Bruges; les évêques de Gand et d’Ypres lèvent des soldats et font défoncer les tonneaux de bière.
En 1635, le roi Louis XIII déclare la guerre au roi d’Espagne ; la Flandre sera le théâtre de nouvelles opérations militaires.
Estaires avait bien à souffrir des passages de troupes et en même temps de certaine maladie contagieuse, comme nous le raconterons dans les pages consacrées aux Récollets. Cette même année on décida de faire de la tour un arsenal et une poudrière, et d’établir des portes et barrières, ce que l’on exécuta deux ans après, peut-être de nouveau.
En 1641, les Français assiègent Aire, ravagent Hazebrouck et les pays de Cassel et Bailleul. Richelieu fait assiéger Lens par de Brézé, et La Bassée par La Meilleraye. Maîtres d’Aire, les Français se portent vers Ypres. Lillers est aux Espagnols, le 4 août. Les ordres de Flandre, Courtrai off’rent des taxes pour arrêter les Français à Lalleu, Lillers et Armentières.
A cette même date, l’archiduc Ferdinand, malade, passe à Estaires, se rendant d’Aire à Armentières. Le duc d’Orléans prend Cassel, Merville; le maréchal de Gassion, Béthune, en août 1645, Saint-Venant et la Motte-au-Bois, Rantzau, Lillers; ils se réunissent devant Armentières, qui se rend. Les Espagnols prennent Cassel au mois d’octobre
L’année suivante, Condé fortifie les places de la Lys. En mai, l’archiduc Léopold prend Armentières, et Gassion s’empare, en juillet, de La Bassée.
Le 29 juillet 1647, une division de troupes espagnoles arrive à Estaires et y séjourne jusqu’au 22 septembre, Peu de temps après, le maréchal de Gassion passe à Estaires, se dirigeant vers Lens. Condé prend Ypres.
Le 5 août 1648, les Espagnols, maîtres de Furnes, s’emparent du château d’Estaires et marchent sur Lens. De Villequier reprend Estaires et y fait prisonnier trois cents Espagnols.
En 1649, les Espagnols reprennent Saint-Venant, Ypres et la Motte-au-Bois. Bailleul est pillé par les Français en 1653.
En août 1657, Turenne, venant de Luxembourg, assiège Saint-Venant, les Espagnols enlèvent ses bagages. Il sacrifie sa vaisselle, enlève la place et va délivrer Ardres. En septembre, il prend et rase La Motte-au-Bois. Il prend Ypres l’année suivante.
|
En 1659, Estaires est espagnole par
le traité des Pyrénées. |
Laissons ici nos regrets s’exprimer pour ces vieux châteaux qui disparaissent. La superbe demeure que La Motte-au-Bois qui avait abrité saint Thomas de Cantorbéry, et dont les tours et les courtines, les créneaux et machicoulis ornaient d’une façon si pittoresque la forêt de Nieppe !
Quel archéologue, quel artiste ne pleure sur ces manoirs disparus! Avec tes grosses tours plongeant dans les vastes fossés, vieux château d’Estaires tout plein .des souvenirs des anciens seigneurs, résumé de l’histoire de la ville avec l’église et l’hôtel de ville, que ne domines-tu toujours fièrement l’entrée de la cité !! (Quelle a été depuis la demeure des comtes d’Estaires à Estaires ? )
En 1690, le marquis de Castanages lève de fortes contributions sur la Flandre française. Estaires souffre beaucoup des passages de troupes en 1706.
En même temps les mendiants devenaient si nombreux que Ch. Le Blanc, intendant de la Flandre, prend des mesures contre la mendicité en 1707; les vicaires généraux de Saint-Omer refusent l’aliénation de certains fonds à Estaires et au Doulieu pour seconder ces mesures. Les pertes causées à la ville, en 1708, par les incursions des ennemis, s’élevaient à 84,000 livres.
La sorcellerie à Estaires
Nous n’avons pas trouvé trace à Estaires d’exécution ni de jugement de sorcières aux XVIe et XVIIe siècles, alors que Bailleul, Merville étaient témoins de sorcières étranglées ou brûlées par ordre du magistrat. Cependant, nous avons entendu souvent dans notre enfance raconter des histoires merveilleuses de sabbats et de sorts jetés, qui nous font penser qu’Estaires a eu aussi des sorciers.
Nous rappellerons un souvenir personnel. On nous conduisit, tout petit, chez une certaine femme, sur la route de Sailly, en réputation de guérisseuse. Mais, dès que notre bonne mère s’aperçut que cette prétendue spécialiste employait des moyens superstitieux et tout cabalistiques, elle s’éloigna justement indignée.
Le spiritisme est trop connu de nos jours pour que l’on rejette dans les mythes la sorcellerie. La mystique diabolique cite des faits sans nombre, pareils à ceux dont on accusait les sorcières de Merville en 1659. Par lettres de 1592, les archiducs ordonnaient de surveiller les personnes soupçonnées de sorcellerie.
Rivalité Estaires-Merville
En 1431, nous avons constaté la rivalité des villes d’Estaires et de Merville. En 1670, la jeunesse de Merville jouait une comédie : Le Mystère de sainte Catherine. Il y avait comme «entre-jeu » une facétie. On représentait un marchand d’allumettes « malheureux en son métier, puisqu’un envieux met le feu à sa botte et brûle toute sa marchandise. » Ainsi le publie Mervillois se divertissait aux dépens des Estairois, qui dès lors avaient la spécialité de la fabrication des grandes allumettes.